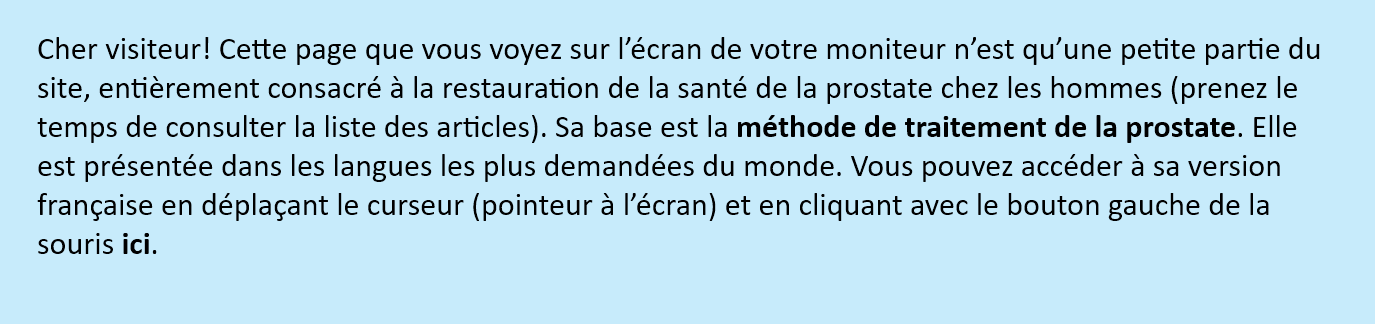À propos des raisons pour lesquelles l’hyperplasie bénigne de la prostate peut se développer et de la manière de la traiter
Contenu mis à jour en 2025–2026.
Conseil important de l’auteur
Dans la mesure du possible, consultez le contenu du site sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un PC tout-en-un. Cela facilitera grandement la visualisation de la structure du site, la navigation entre les sections et la compréhension complète du contenu. Il est également possible d’utiliser un smartphone, mais en raison de la taille réduite de l’écran, certains éléments et la navigation peuvent être moins clairs. Les informations sur les problèmes de la prostate sont présentées ici dans un grand nombre d’articles, et chaque article contient uniquement un bénéfice pratique — sans pages inutiles ni publicité intrusive.
HBP (aperçu général)
Hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est une formation pathologique dans la prostate de l’homme qui ne se propage pas aux autres tissus ou organes ; en d’autres termes, il s’agit d’une tumeur sans apparition de métastases. HBP est une affection urologique fréquente chez les hommes de plus de 40–50 ans, souvent associée à des troubles urinaires et nécessitant un suivi régulier, un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée. Les facteurs de risque incluent la prédisposition génétique, la prostatite chronique, les changements hormonaux liés à l’âge, la baisse de testostérone, le mode de vie sédentaire et une alimentation déséquilibrée. Cette maladie affecte la qualité de vie, la santé sexuelle et la fonction urinaire normale.
Manifestations de l’hyperplasie bénigne de la prostate
La croissance de la prostate ressemble à la formation d’une capsule et est liée à l’augmentation du nombre de glandes para-urétrales. Il existe quatre formes de HBP, chacune ayant des symptômes caractéristiques et des conséquences différentes sur les voies urinaires :
- Subvésicale – croissance de la glande en direction du rectum. Les symptômes douloureux sont minimes ou peuvent ne pas être ressentis. Ce type est souvent détecté lors d’échographies de la prostate de routine ou de contrôles préventifs.
- Intravesicale – croissance de la prostate à l’intérieur de la vessie. Avec le temps, cela provoque un inconfort quasi permanent dans la région vésicale, dû à un excès d’urine résiduelle. Non traitée, cette forme peut entraîner des infections urinaires, une cystite ou une pyélonéphrite.
- Forme rétrotigone – tumeur qui gêne l’écoulement de l’urine de la vessie et comprime l’urètre. Les premiers symptômes incluent des retards involontaires avant la miction et un jet faible. Sans traitement, ces symptômes s’aggravent et peuvent provoquer une rétention complète d’urine nécessitant une intervention urgente.
- Hyperplasie prostatique multifocale – la forme la plus douloureuse, combinant tous les symptômes ci-dessus et pouvant entraîner des complications au niveau des reins et des uretères.
Étiologie de l’hyperplasie bénigne de la prostate
Les causes exactes de la HBP ne sont pas entièrement comprises, mais certains facteurs augmentent le risque et favorisent la progression de la maladie :
- Croissance du tissu prostatique due à une prostatite chronique prolongée, entraînant des modifications structurelles et des troubles urinaires.
- Présence de maladies concomitantes telles que troubles cardiovasculaires, troubles urogénitaux, diabète de type 2, obésité, syndrome métabolique, hypertension et déséquilibres endocriniens.
- Dysfonctionnement des glandes endocrines (déséquilibre hormonal), baisse de testostérone et troubles du métabolisme des androgènes favorisant la croissance prostatique.
- L’HBP est également favorisée par le manque d’activité physique, les habitudes nocives (alcool, tabac), le surpoids, une alimentation malsaine et le manque de connaissances sur l’autosurveillance. Ces problèmes peuvent être aggravés par le stress chronique ou l’hypothermie. Une exposition excessive au soleil peut déclencher ou intensifier les symptômes de la prostatite, de la prostatite chronique et de l’HBP.
- Âge. Les statistiques mondiales montrent que le risque de développer une HBP augmente avec l’âge : environ 7–8 % des hommes de moins de 50 ans sont affectés, 30 % entre 51 et 60 ans, et plus de 75 % des hommes à 70 ans. Les changements liés à l’âge dans le tissu prostatique influencent directement la gravité des symptômes et la nécessité de contrôles urologiques réguliers.
L’HBP et le carcinome, ou cancer de la prostate, sont deux maladies distinctes. À ce jour, aucune corrélation directe n’a été établie, mais des contrôles urologiques réguliers et le suivi du PSA aident à exclure les processus malins et à intervenir précocement.
Symptômes de l’HBP chez l’homme
Les symptômes de l’HBP sont variés, mais se résument au fait que le patient ne peut pas vider complètement sa vessie :
- Fréquentes et urgentes envies d’uriner, de jour comme de nuit, affectant la qualité du sommeil et le bien-être général.
- Difficulté à initier la miction, nécessitant une pause et la contraction consciente des muscles autour de la prostate et de la vessie pour évacuer l’urine à travers le canal prostatique rétréci.
- Envies d’uriner plusieurs fois la nuit, liées à l’irritabilité de la vessie et à la rétention d’urine résiduelle.
- Écoulement urinaire interrompu, diminution du jet urinaire et risque accru d’infections urinaires.
- Jet urinaire faible ou filiforme, signe d’une vidange incomplète.
- Inconfort douloureux dans l’urètre, souvent accompagné de brûlures, irritations ou douleurs post-mictionnelles.
- Inconfort persistant au niveau de la vessie et légèrement en dessous, incluant pression, lourdeur et sensation de vidange incomplète.
- Volume d’urine faible par miction, accumulation d’urine résiduelle, augmentant le risque de cystite et de pyélonéphrite.
- Sensation de vidange incomplète, nécessitant des contrôles urologiques réguliers et un traitement précoce.
Diagnostic de l’hyperplasie bénigne de la prostate
La négligence de l’examen n’est pas raisonnable. Beaucoup doutent de l’efficacité des traitements de l’HBP, surtout ceux qui ont déjà suivi un traitement peu efficace pour la prostatite chronique.
Un diagnostic précis est indispensable, car il existe des méthodes efficaces et performantes pour traiter la prostatite et l’HBP. Ce site présente l’une de ces méthodes.
Le diagnostic complet comprend :
- Examen rectal par palpation réalisé par un médecin expérimenté. Il permet d’évaluer la consistance du tissu prostatique, sa taille (augmentée ou non), la sensibilité et la présence d’un sillon entre les lobes.
- Examens de laboratoire : analyse d’urine, dosage de l’antigène spécifique de la prostate (PSA), analyse sanguine biochimique générale.
- Uroflométrie (vitesse d’écoulement urinaire) – indicateur relatif à mesurer dans différents états : repos complet, après un repas, après le sommeil et après certains exercices physiques (marche, course, natation, gymnastique) si le patient y est habitué.
- Échographie – essentielle pour comprendre la situation globale. Les résultats fiables nécessitent des compétences et un équipement adapté. L’échographie transrectale est la plus précise. Préparer la vessie avec 700-800 g de liquide suffit ; un excès peut provoquer un spasme et fausser les résultats. Avant l’examen, éviter l’immobilité prolongée et marcher activement jusqu’au cabinet. L’échographie permet d’évaluer la présence de corps étrangers, le volume de la prostate (18-20 cm³ pour un organe sain) et la quantité d’urine résiduelle.
- Radiologie – permet de détecter d’éventuelles complications.
Ensemble des manifestations (symptomatologie clinique)
On distingue trois étapes dans le développement de l’HBP, chacune aggravant significativement l’état du patient par rapport à la précédente.
- La première étape est dite compensée. À ce stade, la prostate de l’homme est légèrement augmentée en volume. Les symptômes se manifestent par une courte rétention avant le début de la miction, nécessitant une contraction consciente des muscles de la région de l’aine pour soulager la tension. L’état général empêche la détente et peut même provoquer des troubles psychologiques. Les envies fréquentes, parfois imprévisibles, d’uriner obligent à planifier ses déplacements et à tenir compte de différents facteurs. Les limites de la prostate et de ses lobes sont bien définies, sa consistance est ferme et la palpation ne provoque pas de douleur. Cette étape peut durer un, trois ans, voire plus.
- La deuxième étape est appelée sous-compensée. L’urètre comprimé dans sa partie supérieure empêche une vidange complète, et le patient ressent physiquement la présence d’urine résiduelle dans la vessie. Les efforts fréquents épaississent les parois de la vessie, réduisant sa fonction. Des épisodes d’incontinence involontaire peuvent survenir. La présence constante d’urine résiduelle peut entraîner des complications, telles que la formation de calculs rénaux et vésicaux, ou une insuffisance rénale.
- La troisième étape est décompensée et extrêmement dangereuse. En raison de l’augmentation continue de l’urine résiduelle, la vessie se déforme considérablement. La miction se fait goutte à goutte, entraînant une altération irréversible de la fonction rénale. L’état du patient peut s’accompagner d’une odeur désagréable d’urine, de constipations, de perte d’appétit et, par conséquent, de perte de poids, provoquant un ensemble de problèmes de santé graves.
Traitement de la prostatite et de l’hyperplasie bénigne de la prostate
Traitement de la prostatite chronique
Le lien entre la prostatite chronique et l’HBP est évident : souvent, l’hyperplasie bénigne de la prostate résulte d’un traitement inefficace de la prostatite chronique prolongée. C’est pourquoi les options thérapeutiques sont détaillées ici. La maladie se décline en quatre formes :
- Prostatite bactérienne chronique ;
- Prostatite chronique asymptomatique ;
- Prostatite chronique sous forme de syndrome de douleur pelvienne ;
- Prostatite granulomateuse chronique.
Le traitement de ces diagnostics constitue un défi majeur pour les urologues. La thérapie comprend des médicaments antibactériens, pris par le patient pendant un à un mois et demi. Le syndrome douloureux est soulagé par des suppositoires ou des comprimés. En cas de difficultés urinaires, l’administration de médicaments de la classe des alpha-1-bloquants (Doxazosine, Tamsulosine, Omnic, etc.) est recommandée. Cependant, ce type de traitement n’apporte généralement pas de résultats définitifs : les antibiotiques ne sont souvent pas pleinement efficaces et la maladie peut progresser à nouveau. Pour obtenir un résultat durable, il est nécessaire de renforcer le système immunitaire par un mode de vie sain. Cela demande un effort patient et prolongé, mais les bénéfices en valent la peine. Cela inclut une activité physique régulière mais modérée (exercices spécifiques, course, natation, marche), une alimentation équilibrée et l’élimination complète des habitudes nuisibles.
Traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate
Il n’est pas grave de se tromper si l’on est prêt à analyser et corriger ses erreurs. En revanche, il est très néfaste de vivre dans l’ignorance pendant des années. Souvent, après un diagnostic initial et une consultation urologique, surtout en présence de symptômes faibles, le patient se voit conseiller une attitude d’attente et de surveillance, sans traitement actif de l’HBP. Cette approche est incorrecte. Pourquoi de telles recommandations existent, on peut l’imaginer en partie : d’une part, l’hyperplasie peut ne pas progresser pendant des années au stade initial ; d’autre part, les médicaments ne produisent pas toujours un effet significatif. Il est donc nécessaire non seulement de contrôler régulièrement l’état de la prostate, mais aussi de la traiter activement.
Thérapie médicamenteuse de l’HBP
Deux principales catégories de médicaments sont prescrites :
- Alpha-1-bloquants ;
- Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase.
Les alpha-1-bloquants agissent sur les récepteurs alpha-1 situés au niveau du col de la vessie, de l’urètre et du stroma prostatique. Leur rôle principal est de réduire le spasme des muscles lisses et d’améliorer ainsi la fonction vésicale. Les symptômes d’obstruction urétrale sont ainsi minimisés. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase bloquent la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone, entraînant une diminution du volume prostatique. L’effet se manifeste généralement après six mois à un an, mais il n’est pas garanti. Parmi les effets secondaires possibles figurent la dépression et un changement de la voix, qui peut devenir plus aiguë.
Méthodologie de traitement alternatif (non chirurgical)
Il existe depuis longtemps une méthodologie éprouvée pour traiter la prostatite chronique et l’hyperplasie bénigne de la prostate. Elle est présentée en détail sur ce site spécialisé. L’essence de cette approche repose sur une compréhension correcte des processus physiologiques se déroulant dans l’organisme masculin et sur leur application exacte. Ce traitement est sûr, indolore, très efficace et conduit, à terme, à un état de santé stable.
La base de tout est la gymnastique thérapeutique. Personne ne conteste que ses effets peuvent varier, voire être inexistants si elle n’est pas pratiquée correctement. Une application précise des recommandations méthodologiques améliore significativement les fonctions de défense de l’organisme, la circulation sanguine, stabilise le fonctionnement du cœur et des glandes endocrines. Les techniques de relaxation renforcent encore ces effets. Les organes humains forment un réseau complexe d’interactions, et leur restauration à un état normal constitue la santé. L’apprentissage de cette gymnastique est uniquement interdit en cas de lithiases urinaires.
Le respect des règles alimentaires et du régime nutritionnel est également très important. Un petit-déjeuner copieux et un dîner précoce, l’interdiction de la suralimentation, ainsi que le contrôle du poids doivent être considérés comme des principes de base. Il est recommandé de réduire au maximum les graisses animales et d’augmenter la proportion d’aliments riches en acides gras polyinsaturés oméga-3 et en lycopène. Soyez sélectif lors de l’achat de légumes : choisissez les plus qualitatifs et consommez-en quotidiennement en grande quantité. Limitez la consommation de toutes sortes de viande rouge. L’ensemble des mesures décrites dans les recommandations méthodologiques permet, avec le temps, de retrouver un état de santé stable et durable.
Intervention chirurgicale
La chirurgie est nécessaire lorsque la maladie ne peut être modifiée par d’autres moyens, notamment lorsque l’état est proche du critique, par exemple en cas de rétention aiguë d’urine. L’adénomectomie transvésicale consiste à retirer le tissu prostatique et est pratiquée dans les stades les plus avancés de la maladie. Elle implique un accès à la prostate par une incision dans la paroi de la vessie. Cette opération est très traumatisante et nécessite une longue période de récupération, un suivi et des soins attentifs.
On affirme que ce type d’intervention chirurgicale conduit à la guérison complète de l’HBP, mais les nombreux effets secondaires possibles, parfois imprévus, ne sont pas toujours mentionnés. Aujourd’hui, les interventions peu invasives constituent le standard optimal, car elles sont les moins traumatisantes. Elles ne nécessitent pas d’incision et consistent en un nettoyage partiel (énucléation) de la prostate à l’aide d’équipements spécialisés, tels qu’un laser holmium de puissance adaptée. Ces dernières années, l’embolisation de l’irrigation sanguine de la prostate est de plus en plus utilisée : elle consiste à obstruer les artères qui alimentent la prostate. La nécrose du tissu ainsi provoquée ne peut pas être considérée comme un traitement véritable.
Ainsi, toute intervention chirurgicale doit être considérée comme un dernier recours, lorsque toutes les autres options sont impossibles. La chirurgie n’est ni une panacée, ni le meilleur résultat possible. Les complications après toute intervention chirurgicale incluent :
- Incontinence urinaire ;
- Impuissance sexuelle ;
- Éjaculation rétrograde, lorsque le sperme est redirigé vers la vessie ;
- Déséquilibre hormonal imprévisible.
Les statistiques indiquent un faible pourcentage de décès liés à ces interventions.
Prévention de la prostatite chronique et de l’hyperplasie bénigne de la prostate
Il est important de connaître ces maladies dès le jeune âge. Le facteur héréditaire existe, bien sûr, mais un mode de vie sain, l’activité musculaire régulière, l’évitement de tout préjudice volontaire au corps et la vie avec un minimum de stress contribuent à réduire le risque de ces diagnostics.
Pour prévenir la rétention aiguë d’urine en cas d’HBP, il est recommandé :
- Éviter à la fois le froid et la chaleur excessive (exposition directe au soleil) ;
- Renoncer à l’alcool ;
- Ne pas trop manger, surtout en deuxième partie de journée ;
- Éviter le remplissage excessif de la vessie ;
- Éviter la constipation.
Respectueusement, l’auteur du site, Gennadiy Plotyan.

Cette thématique est disponible dans d’autres langues : УкраЇнська, العربية, Русском, Italiano, Język Polski, Español, English, Türkçe, Português, Deutsch.
Pour poser des questions à l’auteur : العربية, Italiano, Français, English, Język Polski, Deutsch, Türkçe, Español, Português, Українській, Русском.